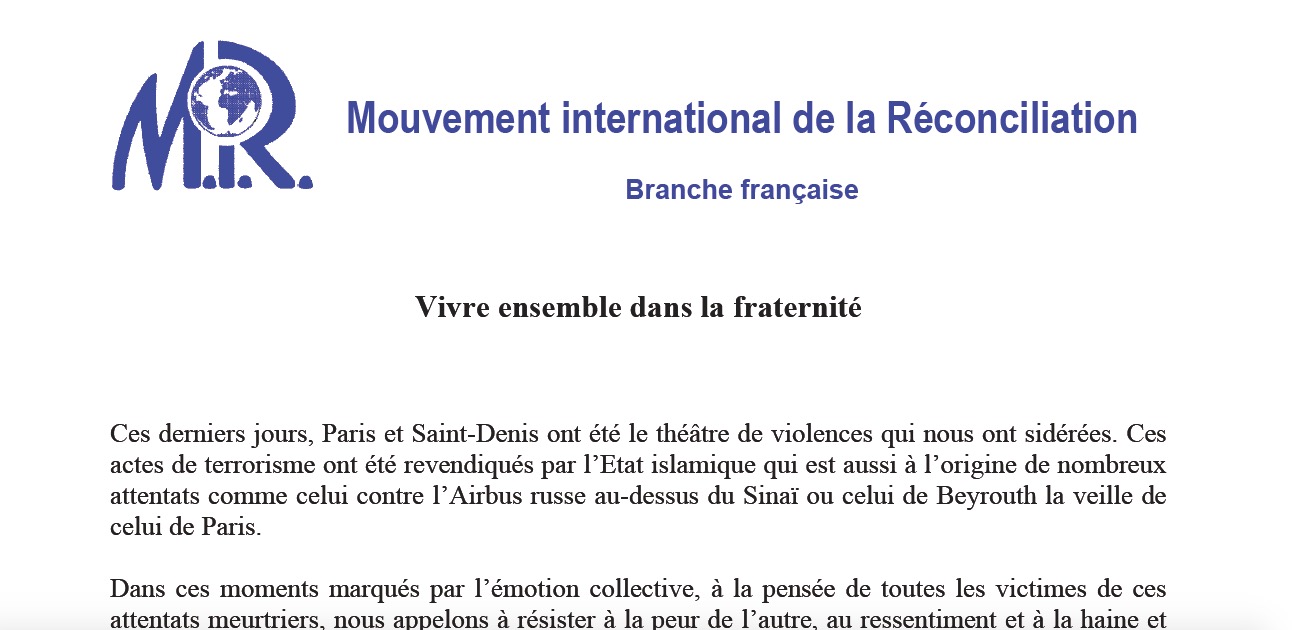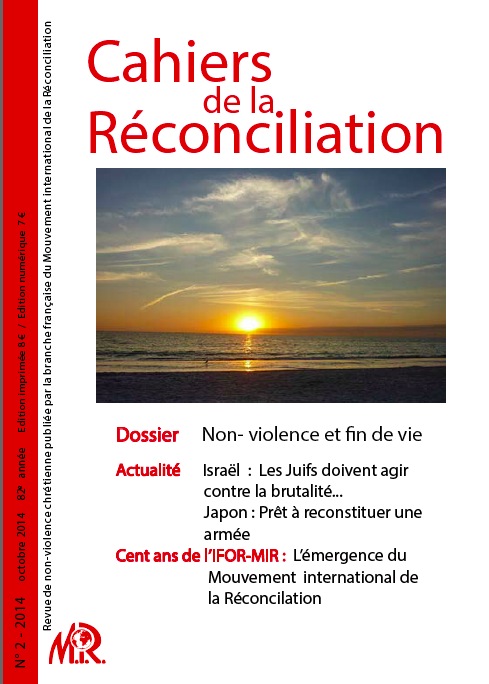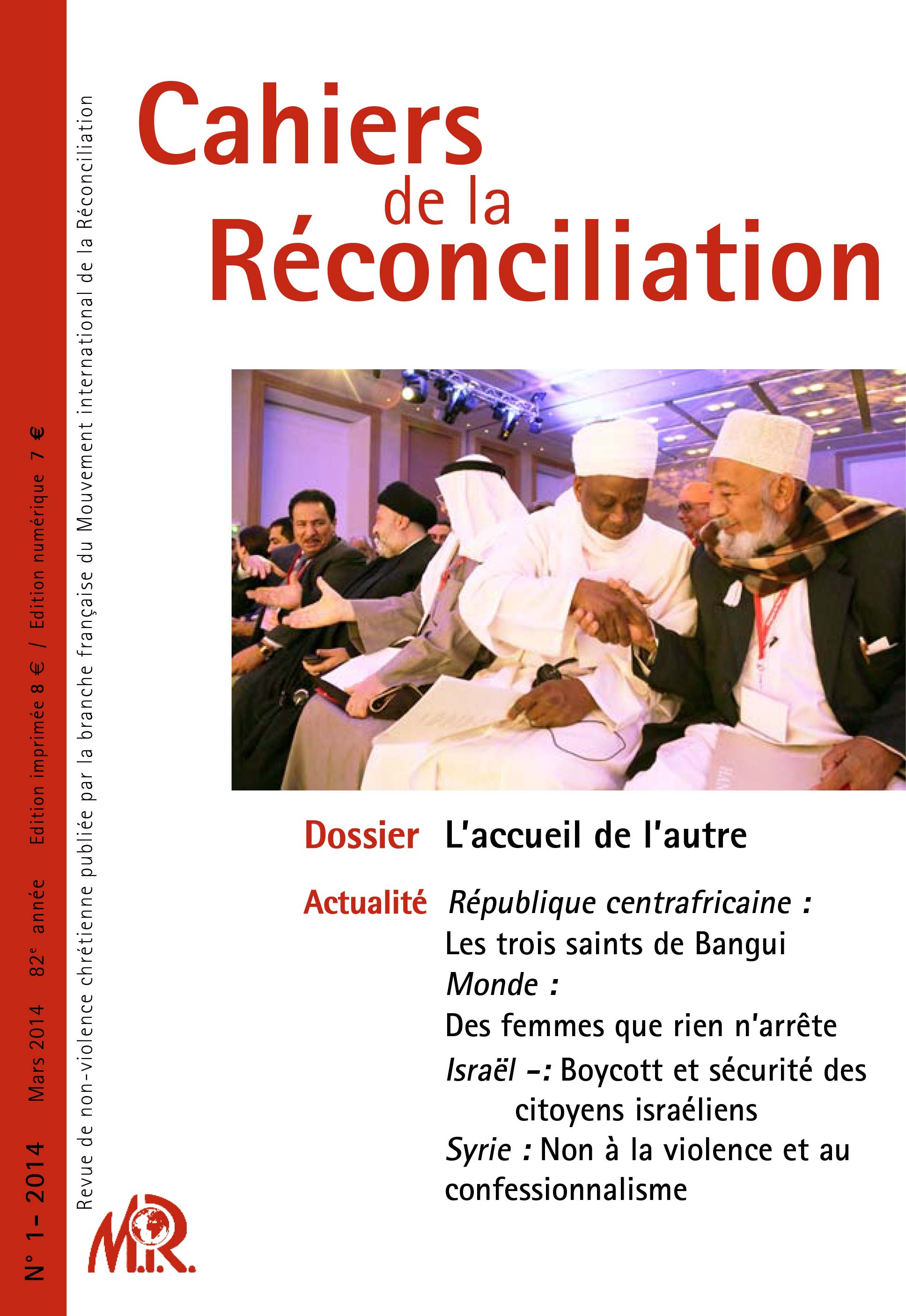Posted on 02 février 2015.
 Face au retour de la guerre contre le terrorisme, les enseignants du Centre de Formation et de Rencontre du Bienenberg viennent de publier une prise de position qui donne des pistes de réflexion et d’action dans la perspective des Églises de paix.
Face au retour de la guerre contre le terrorisme, les enseignants du Centre de Formation et de Rencontre du Bienenberg viennent de publier une prise de position qui donne des pistes de réflexion et d’action dans la perspective des Églises de paix.
Les Etats occidentaux réagissent actuellement contre le terrorisme des milices de l’EI (Etat Islamique) en Irak et en Syrie, avec des frappes aériennes et des livraisons d’armes. Devant les horreurs qui nous sont rapportées, cette réaction est approuvée en bien des endroits, y compris dans les Eglises. Alors que celles-ci protestaient encore largement en 2003 contre l’invasion américaine en Irak, de nombreuses voix se font entendre pour justifier les interventions militaires en les considérant comme une prise de responsabilité conforme à la foi chrétienne.
En tant que Centre de formation du Bienenberg, nous suivons la tradition des Eglises de paix d’après laquelle un engagement pacifiste découle de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus- Christ. Une telle position est une fois de plus remise en question par les événements horribles et menaçants que nous connaissons. Tout d’abord, nous sommes nous aussi profondément ébranlés (si toutefois on peut l’être dans un pays aussi sécurisé que la Suisse) quand nous entendons que des chrétiens et d’autres minorités sont persécutés et mis à mort. Nous ressentons nous aussi de l’impuissance, de la colère et le désir qu’on mette rapidement un terme à ces agissements brutaux. Cependant, nous croyons malgré tout que dans cette situation, des convictions pacifistes ne sont pas devenues illusoires. Au contraire, comme chrétiens, nous sommes mis au défi de chercher dans l’Evangile une relation non-violente avec les ennemis. Nos réflexions s’adressent donc tout d’abord à ceux qui confessent Jésus-Christ comme Prince de la paix et qui le suivent. Nous comprenons son exhortation à aimer ses ennemis comme un appel adressé à l’Eglise d’être le témoin dans ce monde du royaume de Dieu à venir.
Nous partageons avec ces lignes quelques réflexions, encore inachevées, sur des événements qui nous laissent parfois sans voix. Nous exprimer, c’est prendre le risque de paraître lourds et cyniques. Nous sommes bien conscients de ne pas avoir une réponse satisfaisante à tout. Mais nous aimerions partager nos luttes avec les questions oppressantes que posent toujours à nouveau de telles explosions de violence. Certes, nous savons qu’il est facile de parler quand on se trouve à une distance confortable des confrontations et de leurs cortèges de violences. Nous reconnaissons encore bien volontiers que dans le domaine de la prévention, nous sommes restés trop longtemps passifs et nous n’avons de loin pas épuisé toutes les possibilités existantes. Pourtant, nous ne voulons pas nous laisser paralyser par l’impuissance et la résignation. Nous voulons continuer à participer à la « recherche de la paix » (Hb 12.14), humblement et avec l’aide de l’Esprit de Dieu. Ceci, nous le faisons par attachement et par solidarité avec les victimes de ces agissements inhumains. Seigneur, aie pitié !
1RE OBJECTION : LE PACIFISME (CHRÉTIEN) N’EST-IL PAS IRRÉALISTE ET NAÏF ?
En ces jours, certains qualifient le pacifisme chrétien de naïf(1). Un tel reproche n’est pas nouveau. Il est connu et récurrent. Tout au long de l’histoire, on s’est moqué des personnes et des mouvements qui se sont opposés à la logique ambiante de la violence et contre-violence. Certes, les puissants n’ont pas seulement considéré ces personnes comme de doux rêveurs inoffensifs. Ils pressentaient les enjeux et se demandaient, inquiets, ce qu’il adviendrait si elles en convainquaient d’autres à refuser la violence. Ils ont alors souvent donné eux-mêmes rapidement la réponse, sous forme de persécution et de peine de mort. Les anabaptistes en savent quelque chose. Ainsi, la question : « Qu’adviendra-t-il ? » est la plupart du temps restée sans réponse. Et c’est dommage, car avec le recul, bien des récits ont été rapportés d’artisans de paix qui, avec leur pacifisme soi-disant naïf, ont empêché ou arrêté des effusions de sang(2). Ce sont des histoires de revirements inattendus, rendus possibles précisément parce que des personnes ont agi de manière « irréaliste », dans le meilleur sens du terme. Elles se sont exercées à une « culture de la paix »(3), en donnant une réponse alternative à la violence. L’affirmation selon laquelle le pacifisme chrétien serait fondamentalement condamné à l’échec n’est donc pas vraie, même si, bien sûr, le succès espéré n’est pas non plus garanti. Mais chacun sait qu’il en va de même des interventions militaires.
Par ailleurs, nous ne devons pas oublier que le pacifisme chrétien est un chemin qui coûte(4). Il s’apparente en ce sens aussi aux interventions militaires. L’espoir de pouvoir mener une guerre « propre » avec des armes intelligentes, grâce auxquelles on pourrait viser et tuer « uniquement » les terroristes sans faire d’autres victimes, s’est depuis longtemps révélé illusoire. Existe-t-il dès lors une si grande différence entre l’abnégation des soldats armés et celle des chrétiens pacifistes, pour que les derniers seulement soient considérés naïfs et irréalistes ?
2ÈME OBJECTION : SEULE LA VIOLENCE PEUT ARRÊTER LA VIOLENCE
Il y a 11 ans, les Américains ont entrepris de faire tomber le dictateur irakien de l’époque, Saddam Hussein, présenté comme faisant partie de l’ « axe du mal ». La réussite fut fêtée comme le succès rapide d’une puissante machinerie militaire. Mais très rapidement, on s’est rendu compte à quel point la stratégie avait été pensée à court terme. Au lieu de pouvoir se retirer rapidement comme prévu, les troupes de combat américaines se sont retrouvées impliquées dans une guérilla qui a duré de nombreuses années, faisant beaucoup de victimes et occasionnant des dépenses faramineuses. Lorsqu’en 2011 les dernières troupes ont enfin pu être retirées, elles ont laissé derrière elles une région politiquement instable avec un pouvoir inexistant – un vide comblé depuis, de plus en plus souvent, par des groupuscules radicaux. L’intervention militaire a certes écarté un dictateur, mais elle a aussi provoqué de nouveaux excès de violence. Le même phénomène existe en bien d’autres endroits du monde. Benjamin L. Corey demande dès lors à juste titre : « Si c’est l’usage de la violence qui nous a amenés jusqu’ici, pourquoi pensons-nous que davantage de violence pourrait permettre de changer les choses en bien ? ».(5)
Sous le sigle R2P (Responsibility To Protect, « La responsabilité de protéger »), des cercles politiques et religieux se sont prononcés en faveur d’un programme en trois étapes pour résoudre ou empêcher les conflits violents : prévention, réaction, reconstruction (6). L’exemple de l’Irak nous rappelle douloureusement qu’on envisage dans les conflits, dans la précipitation, uniquement des réactions violentes. Celles-ci, au final, non seulement ne résolvent pas les conflits, mais les aggravent parfois. De telles interventions militaires promettent souvent beaucoup plus que ce qu’elles apportent au bout du compte. Qu’adviendrait-il si, dans les situations de grandes tensions, on investissait au moins autant d’argent dans la prévention et la reconstruction (y compris la prise en charge des traumatismes) que dans l’arsenal militaire censé assurer ou rétablir la paix (7) ?
3ÈME OBJECTION : DEVONS-NOUS NOUS CONTENTER D’ÊTRE SPECTATEURS DE CES AGISSEMENTS ?
Non. La théologie de la paix n’est pas synonyme de passivité ni d’indifférence. La situation actuelle exige une réaction. Toute la question est de savoir par quels moyens. Une intervention militaire semble justifiée depuis longtemps. Pourtant, un regard sur l’histoire montre que plus d’une « guerre juste » a été menée pour des raisons douteuses, en contradiction par rapport à l’intention initiale. Quels sont les buts de la coalition internationale en Irak ? Respecte-t-elle elle-même, dans ses interventions militaires, le droit qu’elle exige de ses ennemis ? Pourquoi, dans de nombreux autres cas d’injustice et de mépris de la vie humaine, n’entend-on pas d’appel à la responsabilité de protéger ?
Nous sommes convaincus qu’il faut affronter le mal. Mais la violence ne nous paraît pas être un moyen approprié. Voici quelques alternatives :
– Prier. Beaucoup de chrétiens demandent des choses curieuses à Dieu dans leurs prières. Celui qui demande, par exemple, du beau temps malgré des prévisions météorologiques mauvaises, ne demande-t-il pas à Dieu d’abolir les lois météorologiques ? Pourquoi cette confiance dans la puissance de Dieu disparaît-elle si rapidement lorsqu’il est question de guerre et de paix ? Ces jours, si nous prions pour les victimes et les personnes menacées, et pour les auteurs des violences, nous le faisons dans la confiance en la promesse divine exprimée en Za 4.6 : « Ce n’est ni par la puissance, ni par la force, mais c’est par mon Esprit ».
– Des interventions pacifiques non-violentes. Souvent ignorées par les reportages grand public, certaines personnes prennent le risque de s’interposer sans armes entre deux fronts en conflit, dans différentes régions du monde (8). Elles ne ferment pas les yeux devant le mal, mais le confrontent courageusement par une présence non armée. Dans leur vulnérabilité, elles brisent le schéma classique ami-ennemi, ouvrant parfois des espaces d’action inattendus. Leurs récits, impressionnants, prouvent qu’il existe une « troisième voie ». Ils interpellent et défient les modèles habituels de résolution de conflits.(9) De telles interventions nous rappellent l’importance du contact direct avec les hommes et les communautés religieuses sur place, pour ne pas nous laisser entraîner sans réfléchir, par les médias, dans des distinctions sans nuances entre les « bons » et les « mauvais ». Dans la recherche d’une action adéquate contre le terrorisme de l’EI, nous voulons donc tout particulièrement écouter la voix des chrétiens directement concernés.
– Aide aux réfugiés. L’histoire anabaptiste nous rappelle que beaucoup de personnes ont réagi à la répression et à la persécution en s’enfuyant. Nombre d’entre elles ont fait l’expérience de la solidarité et de l’hospitalité. Aujourd’hui, nous pouvons nous aussi prendre nos responsabilités, animés par une générosité analogue : en contribuant sur place aux premiers secours, en facilitant ici en Europe l’accueil de réfugiés – accueil que nos autorités empêchent encore trop souvent.(10)
– L’engagement de forces policières. Certains cercles chrétiens réfléchissent à l’engagement d’unités de police internationales, dans l’esprit de Just policing. Formées pour la résolution non-violente des conflits et liées par le droit international et les droits de l’homme, de telles unités peuvent intervenir pour protéger les gens. Est-ce possible sans aucune arme ? La question fait débat. Mais même si ces unités de police n’intervenaient que de façon mesurée, par exemple pour sécuriser un couloir humanitaire, ce serait déjà une stratégie radicalement différente comparée à la mise sur pied d’une intervention militaire massive destinée à anéantir l’ennemi. Les cercles de chrétiens pacifistes qui jugent de telles interventions acceptables prônent un « usage de la force sans morts ».(11)
4ÈME OBJECTION : LA BIBLE NE PARLE-T-ELLE PAS D’UNE VIOLENCE NÉCESSAIRE ?
Incontestablement, il y a dans la Bible quelques textes surprenants où la violence est voulue par Dieu, ou tout du moins présentée comme légitime. Il nous paraît toutefois inconvenant d’extrapoler à partir de ces textes pour déclarer que la violence serait parfois nécessaire, ou pour présenter cette position comme une vérité générale. Car les grandes lignes du message biblique, pris dans son ensemble, montrent clairement ce à quoi Dieu tient particulièrement : le shalom, une paix juste. Jésus est celui qui a le mieux révélé cette volonté de paix globale. Sans aucun compromis, il a lutté contre toute pseudo-religion, contre l’injustice et le pharisaïsme, tout en aimant ses ennemis au lieu de les tuer – et ce, même lorsque les autorités politiques et religieuses l’ont condamné à mourir sur la croix. Par la résurrection de Jésus le matin de Pâques, Dieu a dénoncé la logique de la violence, éclairant ainsi la justice accomplie par Jésus et la voie par lui tracée. L’Eglise primitive, en réfléchissant à l’histoire de Jésus, est arrivée à la conclusion que Dieu a répondu à la haine des hommes par un amour réconciliateur (Rm 5.10). Au lieu de rendre les coups, Dieu a embrassé le monde en lui procurant le shalom. Il est évident que Jésus s’est lui aussi donné en exemple, pour montrer comment le shalom peut apparaître parmi les hommes (Phi 2.5-11). En tant que chrétiens, nous nous sentons par conséquent appelés à suivre les pas de Jésus (1 P 2.21 ; Lc 22.49-51) et à vaincre le mal par le bien (Rm 12.21). Ce faisant, nous sommes aussi conscients que rien ne garantit que ce chemin mènera toujours au succès. Au cours des siècles, les artisans de paix ont parfois payé un lourd tribut. Cependant, le message de la résurrection éveille en nous la conviction que ce ne sont pas la haine et la mort qui ont le dernier mot, mais l’amour de Dieu qui restaure. Nous prions donc que notre peur cède la place à cet amour offert, aussi à l’ennemi.(12)
le collège enseignant du Centre de formation du Bienenberg,
Lukas Amstutz, Frieder Boller, Heike Geist, Hanspeter Jecker, Denis Kennel, Bernhard Ott, Michel Sommer, Marcus Weiand, Marie-Noëlle Yoder
16 septembre 2014.
NOTES
�(1) Ce manque de réalisme du pacifisme chrétien a récemment été dénoncé par Reinold Scharnowski dans son article « Allerletzte Möglichkeit ist Waffen-gewalt » (« En dernier recours, la puissance des armes »,http://www.livenet.ch/themen/glaube/glaube/261886-allerletzte_moeglichkeit_ist_waffengewalt.html).
(2)Cornelia Lehn a rassemblé quelques-uns de ces récits dans Histoires d’Hier et d’Aujourd’hui, Cahier de Christ Seul N° 4/1990, et Bonnes nouvelles de par le monde, Cahier de Christ Seul N° 4/1991, Editions mennonites.
(3)Cf. Alan et Eleanor Kreider, Paulus Widjaja : A Culture of Peace: God’s Vision for the Church, Good Books, 2005 (en allemand : Eine Kultur des Friedens: Gottes Vision für Gemeinde und Welt, Schwarzenfeld, 2008).
(4)Ron Sider en a fait l’esquisse dans « Gottes Volk versöhnt » (« Le peuple de Dieu réconcilie »), XI. Mennonitische Weltkonferenz Straßburg, 1984: Hauptansprachen, Strasbourg, CMM, p. 35-39 (en anglais) God’s People Reconciling
(5)theolgiestudierende
(6)Ce concept est expliqué en détail http://www.schutzverantwortung.de. Pour une discussion détaillée dans la perspective des Eglises de paix, voir Jakob Fehr, cf.http://www.dmfk.de/fileadmin/downloads/Fehr_-_R2P_die_Konfrontation_mit_dem_Boesen.pdf.
(7)Pour un exemple d’élaboration d’une stratégie durable en Irak, voir is-there-a-nonviolent-response-to-isis
(8)Comme par exemple les Christian Peacemaker Team (cpt.org)
(9)Voir par exemple deux rapports sur http://mennoworld.org/2014/09/01/cpt-aids-refugees-seeking-safety-in-iraqi-kurdistan et jim-foley-is-and-what-i-learned-from-being-kidnapped.
(10)L’Américain Benjamin L. Corey se demande : « Pourquoi n’organisons-pas le plus grand pont aérien depuis celui de Berlin pour tirer toutes ces minorités religieuses et ethniques de leur détresse et leur offrir l’asile aux USA ? ».
(11)Cf. la conférence de Fernando Enns, « Gerechter Frieden zwischen Interventionsverbot und Schutzgebot » (« Une paix juste entre l’interdiction d’intervention et le devoir de protection », http://friedensbildung-schule.de/sites/friedensbildung-schule.de/files/anhang/medien/fbs-responsibility-protect-449.pdf).
(12)Alice Su témoigne du vécu d’une telle transformation surhttp://gospelworldview.wordpress.com/2014/09/03/1-john-isis-and-the-gospel-versus-terror (en allemand sur bienenberg-blog.ch)
ANNEXE. BIBLIOGRAPHIE EN FRANÇAIS POUR ALLER PLUS LOIN
– Neal Blough, Le pacifisme évangélique : Le pacifisme évangélique
– Collectif, Des pas vers la paix – Recueil d’articles en forme d’impulsions, Dossiers de Christ seul, Editions Mennonites, Montbéliard, 4/2003-1/2004, 124 pages
– Collectif, Guerre ou paix ?, Cahiers de Christ seul, Editions Mennonites, Montbéliard, 4/1992 (avec l’article de John H. Yoder, “Que feriez-vous si… ?”)
– Frédéric de Coninck, Tendre l’autre joue ? La non-violence n’est pas une attitude passive, Farel, Marne-la-Vallée, 2012
– Laserre Jean, Les chrétiens et la violence, Ed. Olivétan, Lyon, 255 p. (première édition en 1965)
– Gabriel Monnet, Tendre l’autre joue ? : Tendre l’autre joue?
– Ron Sider, Explorer les limites de la non-violence au 21e siècle :
Explorer les limites de la non-violence au 21e siècle
– Yoder John H., Jésus et le politique – La radicalité éthique de la croix, Presses Bibliques Universitaires, Lausanne, 1984
– Yoder John H., De la paix du Christ à la « politique » de l’Eglise, collection Perspectives anabaptistes, Excelsis, Charols, 2014, 271 pages
Source : http://www.christ-seul.fr/article.asp?id=2083